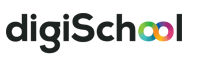Bonjour,
Voici un extrait de wikipedia (provenant de la page Effet Joule-Thompson )
"Tandis qu'un gaz entre en expansion, la distance moyenne entre les molécules s'accroît. Du fait de l'attraction des forces intermoléculaires, l'expansion génère une augmentation de l'énergie potentielle du gaz. [...]
Un second mécanisme qui s'oppose à celui-ci entre en jeu. Lors des collisions des atomes ou des molécules au sein d'un gaz, l'énergie cinétique est temporairement transformée en énergie potentielle (c'est la répulsion des forces intermoléculaires). Or une diminution de la densité du gaz (lors de l'expansion) entraîne une diminution du nombre de collisions par unité de temps, donc une diminution de l'énergie potentielle, ce qui du fait de la conservation de l'énergie entraîne une augmentation de l'énergie cinétique et donc de la température."
Première question : Je comprends le fait qu'un gaz dont le volume se réduit est un gaz dont les molécules vont s'entre-choquer beaucoup plus souvent, ce qui entraine une baisse de l'énergie cinétique et donc une hausse de l'énergie potentielle du gaz. Pourtant, mon intuition me dit qu'un gaz en expansion voit sa température baisser (en général) et qu'un gaz dont le volume se réduit voit sa température augmenter.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment un gaz en expansion voit son énergie potentielle augmenter vu qu'il y a nettement moins de collisions... Selon moi, un gaz en expansion voit ses molécules avoir une vitesse moyenne croissante, ce qui augmente la température du gaz et fait baisser son énergie potentielle, même si mon intuition m'indique le contraire.
Deuxième question : Si j'ai bien compris, le coefficient de Joule-Thompson permet de savoir quand (c'est-à-dire à quelle température) le comportement du gaz va changer, c'est-à-dire à quelle température celui-ci va augmenter sa température lors d'une expansion par exemple et à quelle température celui-ci va baisser sa température lors d'une expansion? En d'autres termes, le coefficient nous sert à savoir quand le comportement du gaz va s'inverser? Est-ce bien cela?
Merci beaucoup :lol3: :we:
Thermodynamique, Coefficient Joule-Thompson
4 messages
- Page 1 sur 1
Bonjour, le plus important ici est de bien comprendre la différence entre le gaz parfait et un gaz réel.
Le gaz parfait est un modèle de gaz dans lequel les molécules n'interagissent pas du tout entre elles. Autrement dit, dans un gaz parfait il n'y a pas de collisions des molécules entre elles et pas d'énergie potentielle interne. Toute l'énergie du gaz parfait est sous forme cinétique, c'est-à-dire sous forme thermique si on suppose qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble. D'où le fait que le gaz parfait a un comportement conforme à l'intuition générale : quand on le comprime adiabatiquement, on exerce un travail sur lui, donc on augmente son énergie ; cette énergie est nécessairement thermique donc la température du gaz augmente. De même, si un gaz parfait se détend adiabatiquement dans un milieu extérieur qui exerce une pression sur lui, le gaz fournit du travail pour pousser le milieu extérieur, donc sa température diminue (un gaz parfait qui se détend dans le vide ne change pas sa température).
Dans un gaz réel c'est plus compliqué parce que les molécules interagissent entre elles. Elles ont notamment tendance à se repousser lorsqu'elles sont trop proches. On peut décrire ce phénomène via une énergie potentielle qui dépend de la distance entre les molécules et qui, à courte distance, devient de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on rapproche les molécules (un peu comme l'énergie potentielle électrique pour deux charges de même signe). Du coup, l'énergie interne du gaz réel a deux composantes : la partie thermique habituelle qui dépend de la vitesse des molécules et la partie potentielle qui dépend de la distance entre celles-ci. La présence de cette énergie potentielle rend l'intuition qu'on a avec les gaz parfaits fausse en général : rien n'interdit maintenant d'imaginer des situations où de l'énergie potentielle est convertie en énergie thermique si le gaz se détend.
Le coefficient de Joule-Thomson décrit la relation entre la température et la pression du gaz lorsqu'il subit une détente isenthalpique. Quand il est positif ça veut dire que le gaz va se refroidir en se détendant (plus le coefficient est élevé, plus il va se refroidir) ; quand il est négatif ça veut dire que le gaz va se réchauffer en se détendant. Il se trouve que les gaz réels ont un coefficient de Joule-Thomson qui décroît avec la température et qui change de signe à une certaine température.
Le gaz parfait est un modèle de gaz dans lequel les molécules n'interagissent pas du tout entre elles. Autrement dit, dans un gaz parfait il n'y a pas de collisions des molécules entre elles et pas d'énergie potentielle interne. Toute l'énergie du gaz parfait est sous forme cinétique, c'est-à-dire sous forme thermique si on suppose qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble. D'où le fait que le gaz parfait a un comportement conforme à l'intuition générale : quand on le comprime adiabatiquement, on exerce un travail sur lui, donc on augmente son énergie ; cette énergie est nécessairement thermique donc la température du gaz augmente. De même, si un gaz parfait se détend adiabatiquement dans un milieu extérieur qui exerce une pression sur lui, le gaz fournit du travail pour pousser le milieu extérieur, donc sa température diminue (un gaz parfait qui se détend dans le vide ne change pas sa température).
Dans un gaz réel c'est plus compliqué parce que les molécules interagissent entre elles. Elles ont notamment tendance à se repousser lorsqu'elles sont trop proches. On peut décrire ce phénomène via une énergie potentielle qui dépend de la distance entre les molécules et qui, à courte distance, devient de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on rapproche les molécules (un peu comme l'énergie potentielle électrique pour deux charges de même signe). Du coup, l'énergie interne du gaz réel a deux composantes : la partie thermique habituelle qui dépend de la vitesse des molécules et la partie potentielle qui dépend de la distance entre celles-ci. La présence de cette énergie potentielle rend l'intuition qu'on a avec les gaz parfaits fausse en général : rien n'interdit maintenant d'imaginer des situations où de l'énergie potentielle est convertie en énergie thermique si le gaz se détend.
Le coefficient de Joule-Thomson décrit la relation entre la température et la pression du gaz lorsqu'il subit une détente isenthalpique. Quand il est positif ça veut dire que le gaz va se refroidir en se détendant (plus le coefficient est élevé, plus il va se refroidir) ; quand il est négatif ça veut dire que le gaz va se réchauffer en se détendant. Il se trouve que les gaz réels ont un coefficient de Joule-Thomson qui décroît avec la température et qui change de signe à une certaine température.
Skullkid a écrit:Bonjour, le plus important ici est de bien comprendre la différence entre le gaz parfait et un gaz réel.
Le gaz parfait est un modèle de gaz dans lequel les molécules n'interagissent pas du tout entre elles. Autrement dit, dans un gaz parfait il n'y a pas de collisions des molécules entre elles et pas d'énergie potentielle interne. Toute l'énergie du gaz parfait est sous forme cinétique, c'est-à-dire sous forme thermique si on suppose qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble. D'où le fait que le gaz parfait a un comportement conforme à l'intuition générale : quand on le comprime adiabatiquement, on exerce un travail sur lui, donc on augmente son énergie ; cette énergie est nécessairement thermique donc la température du gaz augmente. De même, si un gaz parfait se détend adiabatiquement dans un milieu extérieur qui exerce une pression sur lui, le gaz fournit du travail pour pousser le milieu extérieur, donc sa température diminue (un gaz parfait qui se détend dans le vide ne change pas sa température).
Dans un gaz réel c'est plus compliqué parce que les molécules interagissent entre elles. Elles ont notamment tendance à se repousser lorsqu'elles sont trop proches. On peut décrire ce phénomène via une énergie potentielle qui dépend de la distance entre les molécules et qui, à courte distance, devient de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on rapproche les molécules (un peu comme l'énergie potentielle électrique pour deux charges de même signe). Du coup, l'énergie interne du gaz réel a deux composantes : la partie thermique habituelle qui dépend de la vitesse des molécules et la partie potentielle qui dépend de la distance entre celles-ci. La présence de cette énergie potentielle rend l'intuition qu'on a avec les gaz parfaits fausse en général : rien n'interdit maintenant d'imaginer des situations où de l'énergie potentielle est convertie en énergie thermique si le gaz se détend.
Le coefficient de Joule-Thomson décrit la relation entre la température et la pression du gaz lorsqu'il subit une détente isenthalpique. Quand il est positif ça veut dire que le gaz va se refroidir en se détendant (plus le coefficient est élevé, plus il va se refroidir) ; quand il est négatif ça veut dire que le gaz va se réchauffer en se détendant. Il se trouve que les gaz réels ont un coefficient de Joule-Thomson qui décroît avec la température et qui change de signe à une certaine température.
Merci beaucoup Skullkid pour cette réponse très détaillée! :happy: :happy2: :happy3:
Un dernier truc m'embête concernant le coefficent de Joule-Thompson : Pouvons-nous également parler de coefficient de Joule-Thompson dans le cas d'un gaz parfait? Il est impossible qu'un gaz parfait voit sa température augmenter lors de son expansion, non?
Oui, rien n'empêche de calculer le coefficient de Joule-Thomson pour le gaz parfait, et on trouve qu'il est toujours égal à 0. Autrement dit, la température d'un gaz parfait ne change pas lors d'une détente isenthalpique.
Sinon je précise quand même que j'ai pris quelques raccourcis incorrects dans mon explication (genre quand je dis qu'il n'y a pas de collisions dans le modèle du gaz parfait, c'est faux, mais pour le sujet qui nous intéresse ici ça n'a pas d'importance).
Sinon je précise quand même que j'ai pris quelques raccourcis incorrects dans mon explication (genre quand je dis qu'il n'y a pas de collisions dans le modèle du gaz parfait, c'est faux, mais pour le sujet qui nous intéresse ici ça n'a pas d'importance).
4 messages
- Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tu pars déja ?
Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !
Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Identification
Pas encore inscrit ?
Ou identifiez-vous :