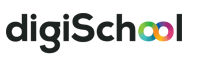La science (latin scientia, connaissance) est, selon le dictionnaire Le Robert, l'ensemble de connaissances, d'études, d'une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables.
Cette définition pose tout dabord le problème de la connaissance. Nous prendrons pour définition de la connaissance quil sagit dune croyance (au sens le plus large: tout ce que lon tient pour vrai) vraie et justifiée. Il tient lieu de bien observer cette définition: la véracité dune croyance quelconque nen fait pas une connaissance, il faut au préalable que cette croyance soit justifiée. Il y a cependant là un parti pris: Platon, par exemple, considérait tout simplement lensemble des connaissances comme lintersection de lensemble des croyances et lensemble des vérités. Ce qui correspond à ce que nous appelons généralement les savoirs. Quoi quil en soit, nous en arrivons au problème de la vérité.
La vérité est la valeur dune idée que lon se fait dun objet qui est conforme avec cet objet, autrement dit, de la conformité entre la pensée et la réalité. Mais quest-ce que le réel?
Ce qui est réel - du latin res, la chose - est ce qui existe effectivement, par opposition à ce qui est seulement imaginé ou rêvé, par exemple. On distingue classiquement la réalité de lapparence, de lillusion, du possible, et enfin du relatif. Cest (entre autres) ce quillustre Platon par la fameuse allégorie de la caverne: il faut se détourner de lapparence changeante et trompeuse des choses pour accéder au monde des Idées, qui est le principe de tout ce qui existe dans le monde sensible (ce qui nexclue pas quil y ait encore un principe au delà de ces Idées). Cest la même idée que lon retrouve chez Dawkins et Dick lorsquils définissent la réalité comme une croyance qui résiste à toutes les aggressions que lon peut lui opposer en pensée, afin dessayer de ne plus y croire. Cette dernière définition me pose problème: si on la prend à la lettre, on ne peut quarriver à la conclusion que la réalité est toujours en suspens, elle nest réalité que jusquà nouvel ordre. Pour éviter cela, je préfèrerais écrire (...) les aggressions que lon pourra jamais lui imposer (...). À moins quil ne sagisse de ce que jappellerai plus loin la réalité phénoménale. À propos de Platon, on peut dire quil y a chez lui un certain pessimisme, dans la prise de distance que cette allégorie implique par rapport à la foi en lhomme et en toute lactivité philosophique ou scientifique qui avait existé avant lui (et éventuellement aussi par rapport à celle qui existera après lui); cependant cette représentation est plutôt optimiste dans le sens où elle laisse à penser que lhomme, par une sorte de doute qui préfigure déjà Descartes, a la capacité à se détourner des apparences illusoires pour saisir le monde en lui-même. En revanche, Kant ira jusquà dire que la réalité pour lhomme nest jamais que celle qui lui apparaît; sa manifestation sensible; et quelle est donc dordre phénomènal, et non pas nouménal; cest-à-dire que nous ne pourrions jamais saisir le monde en lui-même, mais uniquement lappréhender, le com-prendre en nous-même. La réalité ne serait donc pas la vérité? Si, par définition, si lon parle de ce que je prendrai la liberté dappeler la réalité nouménale du monde, mais pas sil sagit de ce que jappellerai sa réalité phénoménale. Quel est le lien entre ce que jai appelé réalité nouménale et réalité phénoménale du monde? Il nous faut pour tenter de répondre à cette question nous arrêter un instant sur la notion de phénomène.
Ainsi que le dit Plank, la couleur rouge est réelle pour le voyant, mais pas pour laveugle. Doù la diversité des réalités, doù la relativité de la réalité, qui nous conduit à refuser daccorder à cette réalité la valeur de vérité. Il y aurait la réalité du monde en lui-même, et la réalité que nous construisons en nous-même sur lui, qui seraient disjointes, la première étant à jamais hors de notre atteinte, sauf à ce que nous devenions des dieux, et acquerrions ainsi ce que nous appelons la transcendance, mais ça, cest une autre histoire... Cependant, réalité phénoménale et réalité nouménale sont-elles à ce point disjointes?
Un phénomène est tout ce qui est perçu en conscience. Il soppose au noumène, qui désigne non pas la chose en tant que la perception quon en a mais en tant que ce quelle est en elle-même. Kant nest pas le premier à avoir opposé la réalité sensible à la réalité vraie, mais cest généralement à lui que ramène le vocabulaire ici utilisé. Le philosophe allemand est parti de la question Que puis-je savoir?, et a ainsi établi que la connaissance des objets dépend du sujet connaissant autant que de lobjet lui-même. Pour lui, connaître, cest organiser au moyen de sa sensibilité et de son entendement ce qui est donné par lexpérience. Quoi de plus juste? Là où je ne suis plus daccord avec ce philosophe, cest lorsquil résume ainsi: Les objets se règlent sur notre connaissance.. En effet, cette dernière formule, qui donne limpression que le sujet connaissant est le seul à avoir quelque responsabilité dans le résultat de lexpérience, laisserait croire que la réalité phénoménale du monde est une construction totalement détachée de sa réalité nouménale, et donc amènerait tout scientifique, ou philosophe, en un mot, quiconque dont la curiosité face à quelque phénomène que ce soit lamènerait à sinterroger pour essayer dapprocher un peu plus la réalité du monde, à devenir sceptique, à renoncer. Et cela nest pas sans me poser problème.
En effet, prenons lexemple suivant, dont nous allons voir quil semble dans un premier temps pousser à accréditer la thèse de la totale subjectivité de la réalité phénoménale, et donc à nier tout espoir dapprocher la réalité nouménale du monde, mais que ce nest en vérité quune apparence: La couleur rouge est réelle pour le voyant, mais ne lest pas pour laveugle. De là, on est tenté de conclure à une diversité des réalités. Cependant, observons un peu plus précisément: il ny a pas à proprement parler de différences entre les connaissances de laveugle et celles du voyant. Là où les deux individus partagent une connaissance, elle est la même pour lun et pour lautre. Ce que lon peut dire, cest qui voit possède au moins une connaissance que celui qui ne voit pas na pas: celle de la couleur (reouge, en loccurence). Le degré de croyance accordé par le voyant (non daltonien) en lexistance des couleurs est vrai. Il ny a pas de raisons pour que laveugle, lui, y accorde le degré de croyance faux! Au pire, il conclura que la question est de nature indécidable: il lui est impossible de dire si oui ou non ce que les voyants appellent couleur existe. Au mieux, un peu de science et de réflexion lui permettront de conclure quil est raisonnablement envisageable que, de même quil est capable dentendre des sons, cest-à-dire quil est muni de récepteurs dont le rôle est de capter certaines modifications de la pression du fluide ambiant et de les porter à sa conscience, des êtres vivants soient munis de récepteurs dont le rôle serait de mesurer les variations du champs électromagnétique environnant, et les porter à leur conscience, et que, de même quune modification de la fréquence de londe mécanique progressive que nous appelons son entraine une modification de son image en nous, une modification de la fréquence de londe électromagnétique que nous appelons lumière entraine de même une modification de limage quelle aura dans la conscience de celui qui est capable de la ressentir, le voyant, doù la notion de couleurs. Alors, évidemment, on peut être tenté de prendre de la distance avec un tel raisonnement, qui semble idéalisé, et irréalisable. Comment diable laveugle, quand bien même il serait doué dune imagination débordande, pourrait-il imaginer une telle chose? Je répondrai que cet aveugle a probablement déjà eu loccasion de dialoguer avec un voyant, et que même si tout le monde était aveugle, une telle imagination ne serait pas impossible; les hommes se seraient probablement rendu compte de lexistence de tels phénomènes même sans avoir la chance de posséder des organes qui les leur rendent immédiatement sensibles: par lobservation de turbulences sur dautres phénomènes qui eux leur sont sensibles notamment. Et ces suppositions nont rien dextraordinaire, à la vue des formidables capacités de lêtre humain! Cest ainsi, par exemple, que, si notre misérable pensée est finie (puisque jusquà preuve du contraire nous sommes des êtres mortels) et discrète, nous sommes capables denvisager des phénomènes continus à linfini. Cest aux mathématiques (qui ne sont pas une science) que lon pense en lisant cela, mais on peut donner des exemples propres aux sciences: lhomme est parvenu à savoir quil existe des rayonnements électromagnétiques de longueur donde inférieure à trois-cent-quatre-vingt nanomètres (les ultraviolets) et dautres de longueur donde supérieure à sept-cent-quatre-vingt nanomètres (les infrarouges), alors que ceux-ci ne lui sont de façon générale pas immédiatement sensibles. De même, la notion de courant électrique nous est familière alors que nous ne possédons pas de sens physique du courant électrique (nous pouvons en ressentir les effets secondaires, certes, mais il sont pareils à ceux causés par une brulure, par exemple).
Ma pensée, optimiste, est donc que la réalité phénoménale nest pas si éloignée de la réalité nouménale du monde que lon serait au premier abord tenté de le croire.