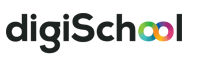L'entropie est de loin lun des concepts qui m'a le plus intéressé en physique. La première définition que j'en ai eu était fort simple: "fonction définissant l'état de désordre d'un système". En approfondissant le sujet jai découvert lampleur du champ dapplication de lentropie.
Dans une émission, j'ai appris que lon ne pouvait parler de désordre pour désigner l'entropie que si lon se plaçait à léchelle des atomes et des molécules. Au niveau macroscopique, il est plus prudent de parler de dégradation, de perte d'information. La physicienne de cette émission avait pris l'exemple du morceau de sucre: avant de le plonger dans du café, on possède une certaine information sur lui, on connaît sa structure puisquon la fabriqué. Une fois qu'il s'est dissous dans le café, on a perdu de linformation, une structure organisée a été réduite en soupe de molécules. On ne saurait pas dire comment ses molécules se sont réparties dans le café car ce phénomène est soumis au hasard. Lentropie de lensemble a alors augmentée.
Dans « Lheure de senivrer », Hubert Reeves parle beaucoup dentropie, il explique notamment que Lévi-Strauss (un anthropologue, ethnologue et philosophe français) pensait que lentropie de lunivers ne pouvait quaugmenter. Selon ce dernier, elle était très faible aux premières secondes de lunivers et na fait quaugmenter. Il considérait lhomme comme un agent créateur dentropie parmi les autres. Voici dailleurs un petit extrait de son texte pour mieux comprendre sa pensée :
Lévi-Strauss, Tristes tropiques a écrit:Loin que ce rôle (rôle de lhomme) lui marque une place indépendante et que leffort de lhomme même condamné- soit de sopposer vainement à une déchéance universelle, il apparaît lui-même comme une machine, peut-être plus perfectionnée que les autres, travaillant à la désintégration dun ordre originel et précipitant une matière puissamment organisée vers une inertie toujours plus grande et qui sera un jour définitive. [ ] Depuis quil a commencé à respirer et à se nourrir jusquà linvention des engins atomiques et thermonucléaires en passant par la découverte du feu et sauf quand il se reproduit lui-même-, lhomme na rien fait dautre quallégrement dissocier des milliards de structures pour les réduire à un état où elles ne sont plus susceptibles dintégration.
Ensuite Reeves va montrer tout au long de son livre en sappuyant par exemple sur le rayonnement fossile que par rapport au texte de Lévi-Strauss, tout est à lenvers. La léthargie thermique ne se situe pas dans lavenir, mais dans le lointain passé.
Reeves consacre un chapitre à la fertilité des déséquilibres, où il aborde le principe de la surfusion, également très intéressant. Ce que jen ai retenu cest quil faut des différences, des déséquilibres pour réduire lentropie. En résumé Reeves montre que loin de samenuiser, à léchelle cosmique, linformation est sans cesse croissante. Donc on peut dire que lentropie diminue il me semble.
Voilà où je veux en venir : dans « Dernière nouvelles du cosmos », Reeves relie lentropie à la qualité de lénergie, il ne parle plus du tout dinformation. Il insère lentropie dans son chapitre sur les propriétés du cosmos primordial. Il va montrer que, comme les autres propriétés, lentropie de lunivers primordial est faible. Que le rayonnement fossile présente une remarquable isothermie (très faibles différences de température), que lunivers présente une faible courbure (faible différence par rapport à la géométrie plane), une faible rotation, je peux le comprendre mais il me semble quil y a une contradiction entre isothermie et faible entropie.
Il donne 2 raisons à la faible valeur de lentropie initiale : la qualité largement supérieure de lénergie gravitationnelle et la rareté des trous noirs primordiaux. Je veux bien mais plusieurs passages me font penser que Reeves à changé davis depuis « Lheure de senivrer », on dirait quil est daccord avec Lévi-Strauss maintenant : lentropie ne fait quaugmenter.
Voici le passage qui ma intrigué :
Reeves, Dernières nouvelles du cosmos a écrit: Considérons le nuage interstellaire qui a donné naissance au Soleil. En cédant à lappel de la gravité, cest-à-dire en « tombant », cette nappe de gaz et de poussière transforme entièrement son énergie (potentielle) gravitationnelle en énergie lumineuse (létoile brille), thermique (elle est chaude) et mécanique (elle accélère le vent solaire). Lentropie du nuage protosolaire saccroît tout au long de ces transformations. [ ] Les observations indiquent que lunivers ancien avait une entropie extrêmement faible.
Il dit aussi que les naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs sont les objets les plus entropiques de lunivers. Avant javais compris que lentropie de lensemble de lunivers augmentait, mais que localement, dans les étoiles et les supernovae, lentropie diminuait, précisément lors de la nucléosynthèse, pour former les éléments que nous trouvons sur terre. Je pensais que les créations de lhomme diminuaient lentropie, comme par exemple les processeurs, que toutes les formes dorganisation que pouvait concevoir lhomme augmentaient la néguentropie (entropie négative).
Alors voilà jaimerais quon mette les choses au clair avec lentropie. Lentropie des étoiles ne fait-elle quaugmenter ? Il y a vraiment un problème entre les 2 livres de Reeves parce que je me rappelle bien que dans le premier il disait que plus il y avait une grande différence entre la température de létoile et celle du milieu interstellaire, plus son entropie diminuait. Les photons que lastre émet augmentent lentropie de lespace intersidéral et permettent à létoile ou la planète de diminuer son entropie. Dès lors jaimerais comprendre : quand lentropie est-elle la plus faible ? Dans la soupe primitive malgré le manque de déséquilibre ou dans le cur des étoiles et les projections des supernovae ?
Peut-on dire que normalement lentropie dun cerveau humain diminue avec lâge ? Peut-on dire que les mécanismes de la reproduction diminuent lentropie en créant une nouvelle structure complexe ?
Quen est-il de lentropie du point de vue de la terre ? Peut on dire quelle diminue globalement ? Augmente-t-on lentropie de façon significative en rejetant tout ce carbone dans latmosphère ?
Ce nest pas clair, finalement lentropie du cosmos augmente ou pas ?